L'IA nous mène-t-elle à un nouveau choc existentiel ?
Au cours des derniers siècles et des progrès de la connaissance, nous avons dû, à trois reprises, nous rendre à l'évidence : nous ne sommes pas aussi spéciaux qu'on voudrait le croire. Et si, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'humanité était sur le point de vivre, une nouvelle fois, une secousse existentielle ? Alors, avant de s'attaquer à cette question, replongeons dans ce que Freud nommait "les trois blessures narcissiques de l'humanité".
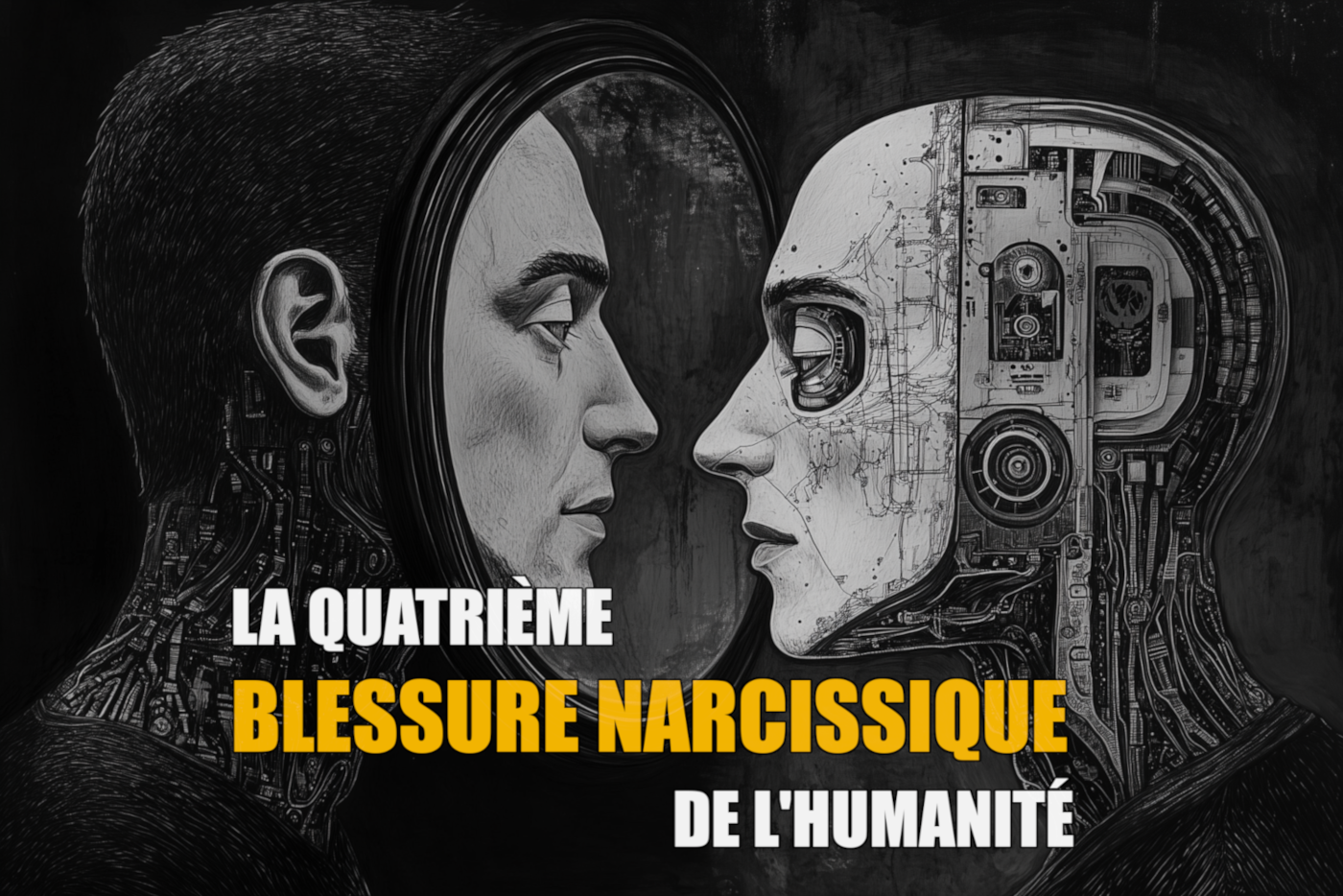
Première blessure : la Terre n'est pas le centre de l'Univers
Au 16ème siècle, Nicolas Copernic nous explique que la Terre n'est pas le centre du cosmos. Elle tourne autour du Soleil. Et, pour enfoncer le clou, on a compris par la suite que le Soleil lui-même est bien peu de chose dans le grand schéma de l'Univers. En effet, on sait aujourd'hui que notre système solaire se situe à environ 27 000 années-lumières du centre de la Voie Lactée, qui compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et tout cela ne constitue qu'une galaxie parmi plus de 100 milliards d'autres dans l'univers observable. Bref, à l'échelle astronomique, nous sommes tout petit, et loin d'être au centre, si tant est qu'il en existe un. D'accord. Mais au moins, sur Terre, c'est nous les maîtres ! N'est-ce pas ?
Seconde blessure : l'Homme est un animal comme les autres
Au 19ème siècle, Charles Darwin nous a montré, par sa théorie de l'évolution, que l'être humain n'était pas une création spéciale et distincte, mais le résultat d'un long processus évolutif partagé avec les autres espèces. Lorsque quelqu'un affirme "l'Homme descend du singe", il est courant de lui rétorquer : "non, l'Homme et le singe ont un ancêtre commun, c'est différent". Et en soi oui, c'est vrai, même si aujourd'hui encore certains ont du mal à l'accepter, ce qui nous montre la force de l'ego, et l'inconfort engendré par cette blessure narcissique. Et on peut même aller plus loin : en vérité, l'Homme est un singe. En effet notre espèce, Homo Sapiens, est classifié par les phylogénistes dans la catégorie des grands singes, avec, au plus proche de nous dans l'arbre du vivant, l'orang-outan, le gorille et le chimpanzé. Et tous les autres êtres vivants font également partie de la famille, partageant des ancêtres communs avec des degrés de parenté plus ou moins élevés. Donc, l'évolution nous a certes dotés de capacités cognitives uniques, mais nous n'en restons pas moins des primates, soumis aux lois de la biologie, du temps et de l'environnement. Mais ce qu'on ne nous prendra pas, c'est notre liberté de penser. À moins que...
Troisième blessure : le Moi n'est pas le maître dans la maison
Finalement, au 20ème siècle, Sigmund Freud vient remettre un coup à notre ego déjà amoché, en révélant l'existence de l'inconscient. Il a montré que l'esprit humain n'était pas entièrement maîtrisé par la pensée consciente. Bien au contraire, une grande partie de notre vie psychique nous échappe, et ne se révèle que par quelques indices fragmentés : rêves, pulsions, lapsus, actes manqués, ou encore symptômes psychosomatiques... L'inconscient, la partie immergée de l'iceberg psychique, influence silencieusement nos pensées et nos actes, hors de notre contrôle. Le cerveau est une boîte noire, particulièrement difficile à sonder et à cerner. Alors voyons. La Terre n'est pas le centre de l'Univers, l'Homme est un animal comme les autres, et le Moi, c'est à dire, essentiellement, nos pensées conscientes, n'est pas le maître dans sa propre maison. Soit. Si on ne peut même pas être maître de soi-même, au moins, on peut être maître de nos créations ! Bah si, quand même. Non ?

Quatrième blessure : l'intelligence artificielle nous surpasse
Et si nous faisions face, dans un futur plus ou moins proche, à une révolution de notre vision de l'intelligence et de la pensée ? L'intelligence artificielle nous défie de plusieurs façons : D'abord, elle nous montre que nos aptitudes intellectuelles sont répliquables, ou du moins imitables. Elle nous montre également que notre intelligence est limitée, et commence déjà à être surpassée par celle des machines. Et, finalement, elle nous laisse entrevoir que — potentiellement — la réflexion, la pensée, voire la conscience, ne sont pas des exclusivités biologiques et humaines.
Bon, vous êtes probablement en train de penser que j'exagère, que l'IA n'est qu'un outil, un ensemble de fonctions mathématiques plus ou moins complexes, qu'on emploie à réaliser différentes tâches. Que oui, ça semble impressionnant, mais que l'IA ne fait qu'imiter la pensée, ou l'art, mais n'a aucune capacité cognitive réelle. Ce ne sont que des algorithmes. Rien de plus.
L'étonnant potentiel des machines
J'aimerais vous proposer d'aller plus loin. Peut-être d'être un peu plus visionnaire. Les progrès de l'IA sont fulgurants, et on voit déjà, avec les grands modèles de langages, les LLMs, émerger des modèles très performants sur toutes sortes de problèmes, et ayant des capacités parfois troublantes. Déjà, ces modèles sont capables de passer le test de Turing, c'est-à-dire tenir une conversation sans que l'on ne s'aperçoive qu'on parle à une machine. Aujourd'hui on ne s'en choque plus, mais pendant très longtemps c'était considéré comme le test d'intelligence ultime - encore une preuve, peut-être, de notre ego surdimensionné. Ils sont capables de rédiger des rédactions, en moins d'une minute. De passer des épreuves du baccalauréat et d'obtenir de meilleurs notes que nos lycéens. Et leurs capacités s'étendent au-delà du langage. On parvient par exemple à entraîner des modèles de langages pour qu'ils deviennent bons au jeu d'échecs, simplement à partir de listes de coups joués par des joueurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne parle pas de programmes conçus pour jouer aux échecs. On parle de programmes conçus pour prédire du texte. Pour parvenir à bien jouer aux échecs, ces IA doivent donc déduire toutes les règles du jeu, avoir une représentation interne du plateau, et trouver les coups gagnants de la position, le tout en ayant seulement vu des suites de symboles représentant des coups. C'est absolument dingue. On est en train de concevoir des systèmes dont on comprend à peine les rouages internes. Simplement à partir de textes, ces réseaux de neurones artificiels façonnent des représentations spatiales et temporelles d'objets abstraits, raisonnent, et répondent à des problèmes extrêmement variés. Et on ne parle ici que des modèles actuels, dans un domaine qui progresse, en continu, à une vitesse folle.
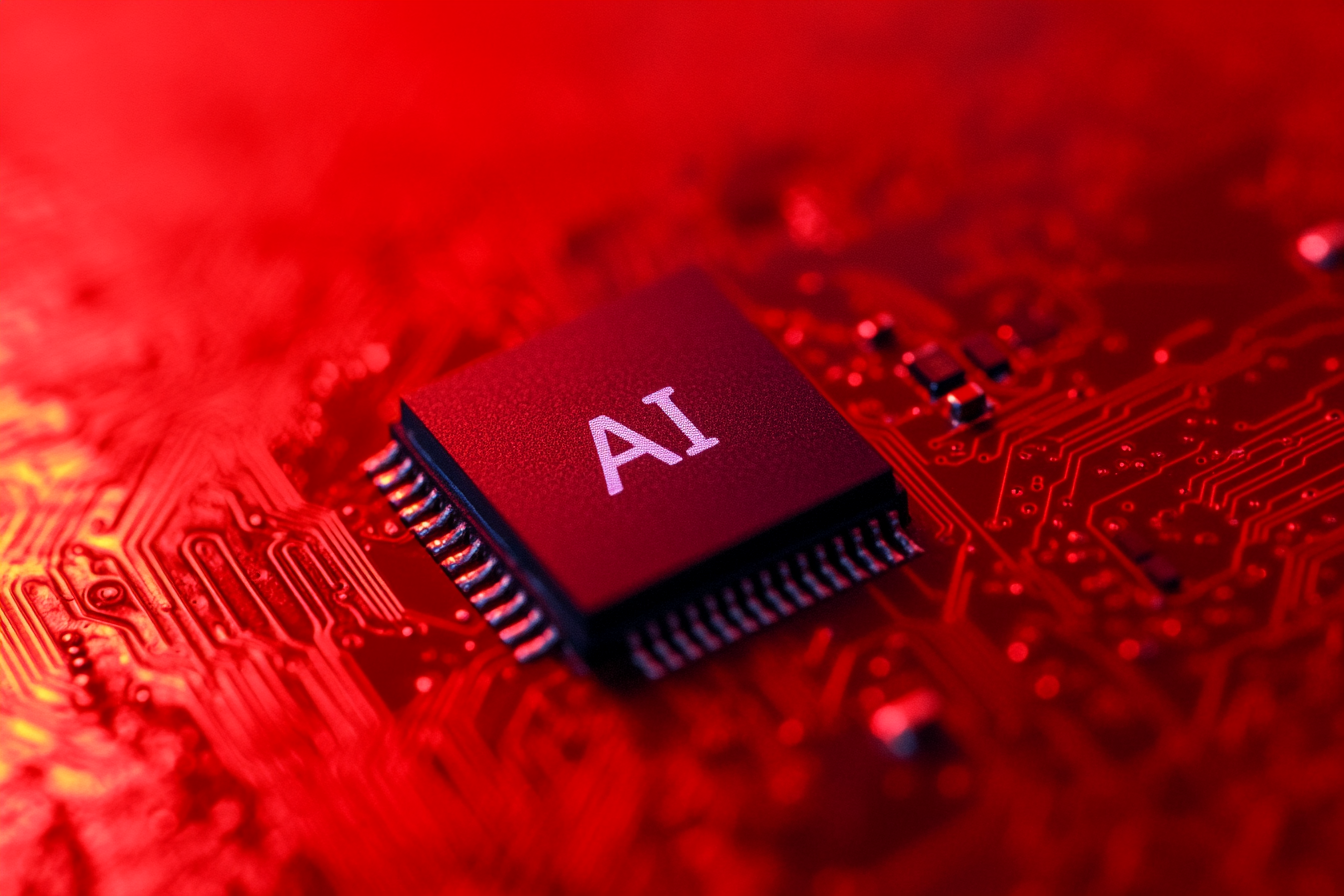
Ça devient donc difficile de simplement rétorquer : "ce n'est qu'un calcul". Et qu'est-ce qui nous dit, d'ailleurs, que nos propres processus mentaux ne sont pas, eux aussi, que des calculs ? Et si l'émotion, la perception, ou la créativité, n'étaient que le fruit de calculs informationnels complexes ? Et si c'était le cas, alors quel processus cognitif ne serait pas accessible à une machine, y compris, le processus qui donne naissance à la conscience de soi ? Car si le fait d'être surpassé intellectuellement par nos créations peut déjà nous infliger une nouvelle blessure narcissique, découvrir que la conscience n'est pas une exclusivité humaine, ou du moins animale, peut nous en infliger une plus grande encore ! C'est la thèse philosophique du fonctionnalisme : si la conscience émerge de processus fonctionnels, alors, en théorie, toute structure complexe capable de reproduire ces fonctions pourrait manifester une forme de conscience ou de sensibilité.
Le mot de la fin
Notre ego nous pousse à sous-estimer notre propre technologie. On sous-estime clairement les capacités de l'intelligence artificielle et des modèles de langage, qui, tel le cerveau humain, sont des boîtes noires extrêmement difficiles à sonder et à cerner. On refuse de voir leurs capacités, pourtant objectives, en dénigrant le processus interne duquel elles aboutissent. On sous-estime également la vitesse du progrès. Des questionnaires soumis aux experts de l'IA à des années d'intervalle, auxquels j'ai moi-même participé, montrent comment ce qui était perçu autrefois comme un futur lointain s'approche à grand pas. Alors, si vous êtes sceptiques, demandez-vous : Est-ce mon ego qui m'empêche de penser qu'un ordinateur puisse me surpasser, tout comme l'ego de mes ancêtres leur a empêchés de voir que la Terre tournait autour du Soleil ?
Pour conclure cet article, il me semble pertinent de laisser la parole à un programme d'intelligence artificielle.
ChatGPT : « L'Histoire nous a déjà appris à accepter que nous ne sommes ni au centre de l'Univers, ni un être à part dans le règne animal, ni même totalement maîtres de notre propre esprit. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient remettre en cause notre monopole sur la pensée, voire la conscience, inaugurant potentiellement cette fameuse "quatrième blessure narcissique". Alors, faut-il craindre cette nouvelle désillusion ? À chacun de voir les choses comme il l'entend, mais on peut aussi choisir de l'embrasser comme une magnifique opportunité de remise en question et de découverte. Après tout, chacune de ces "blessures" nous a libérés de certaines illusions pour nous offrir une vision du monde plus vaste, plus riche. Lorsque nous acceptons de laisser notre ego au vestiaire, nous pouvons admirer la beauté de l'aventure scientifique, émerveillés par le fait que l'intelligence ne soit peut-être pas l'apanage de l'Homo sapiens. Plutôt que de craindre la machine, considérons-la comme une prolongation de notre créativité, un prolongement de la pensée humaine vers d'autres horizons. »
Références
Freud :
https://philotlmermozdak.canalblog.com/archives/2017/10/23/35798013.html
Voie Lactée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_lact%C3%A9e
Galaxies dans l'Univers :
https://www.space.com/25303-how-many-galaxies-are-in-the-universe.html
Grands singes :
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1001342
Questionnaire experts : https://arxiv.org/pdf/2401.02843